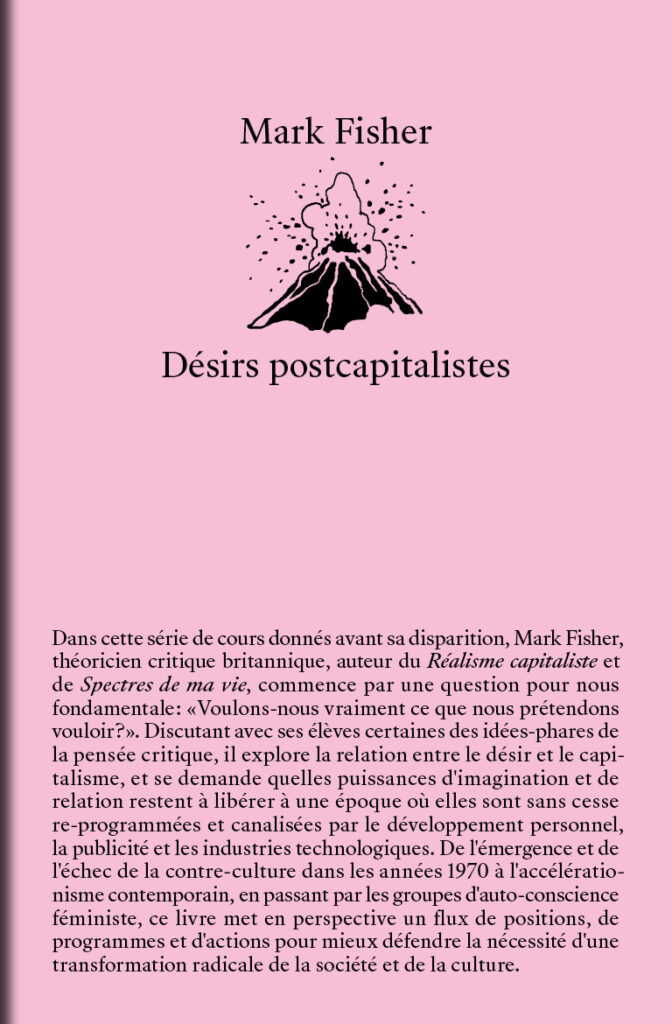Invitation au désir
“Si l’on parle de postcapitalisme, c’est qu’il s’agit d’une victoire et d’une victoire qui se fait en traversant le capitalisme. On n’est pas simplement contre le capitalisme – on parle de ce qui se passera, une fois que le capitalisme sera arrivé à sa fin. On part de là où nous sommes.“ Mark Fisher
J’ai écrit un premier texte sur le désir. Il s’intitulait « Le jour où le désir intégrera le DSM ». Il constituait en quelque sorte le pendant dystopique, bien que tout à fait réaliste, de celui que je vais tenter de vous livrer ici-même. Lorsque je créé de la musique, il m’arrive très régulièrement de tourner autour. C’est une tâche besogneuse et ingrate. Des heures défilent avant que le brouillon ne se transforme en morceau, avant que ne jaillisse quelque chose qui me semble suffisamment clairvoyant et solide pour que je l’enregistre. Au contraire, lorsque je joue de la musique, que je sélectionne des disques et construis un agencement jusqu’à tendre à écrire un récit, je manie des intensités que sont les musiques des autres, des enregistrements fameux. Pour être à leur hauteur, je dois les jouer, les traverser et, si j’exécute un set en public, emmener ce même public avec moi. Ici, rien n’est besogneux, tout réside dans le mouvement.
Alors voilà, je vais écrire ce texte d’un trait, sans me retourner. Je vais partir d’où je suis, pour aller jusqu’au désir, en tentant, je l’espère de vous emmener avec moi, sans saturer mon texte de références, sans être le bon élève éduqué à un certain académisme. Je ne définirais rien. Je vais suivre le mouvement.
Le désir naît avec le souffle. Peut-être naît-il déjà dans le ventre maternel, avec l’ouïe. Je me plais à penser qu’écouter constitue l’acte primitif du désir. Nous naissons et nous sommes projetés alors dans ce labyrinthe qu’est le désir. Désirer.
Le désir est un agencement fragile, dont la psychanalyse, érigée comme maitresse es désir, s’est pourtant révélée assez défaillante à saisir. Le désir a quelque chose d’aussi insaisissable qu’évident. Si je me souviens de mes cours de français, ce doit être un oxymore, ou pas loin.
Où en sommes-nous avec notre désir?
Après 40 ans d’offensive triomphante du néolibéralisme, où pouvons-nous bien être avec notre désir?
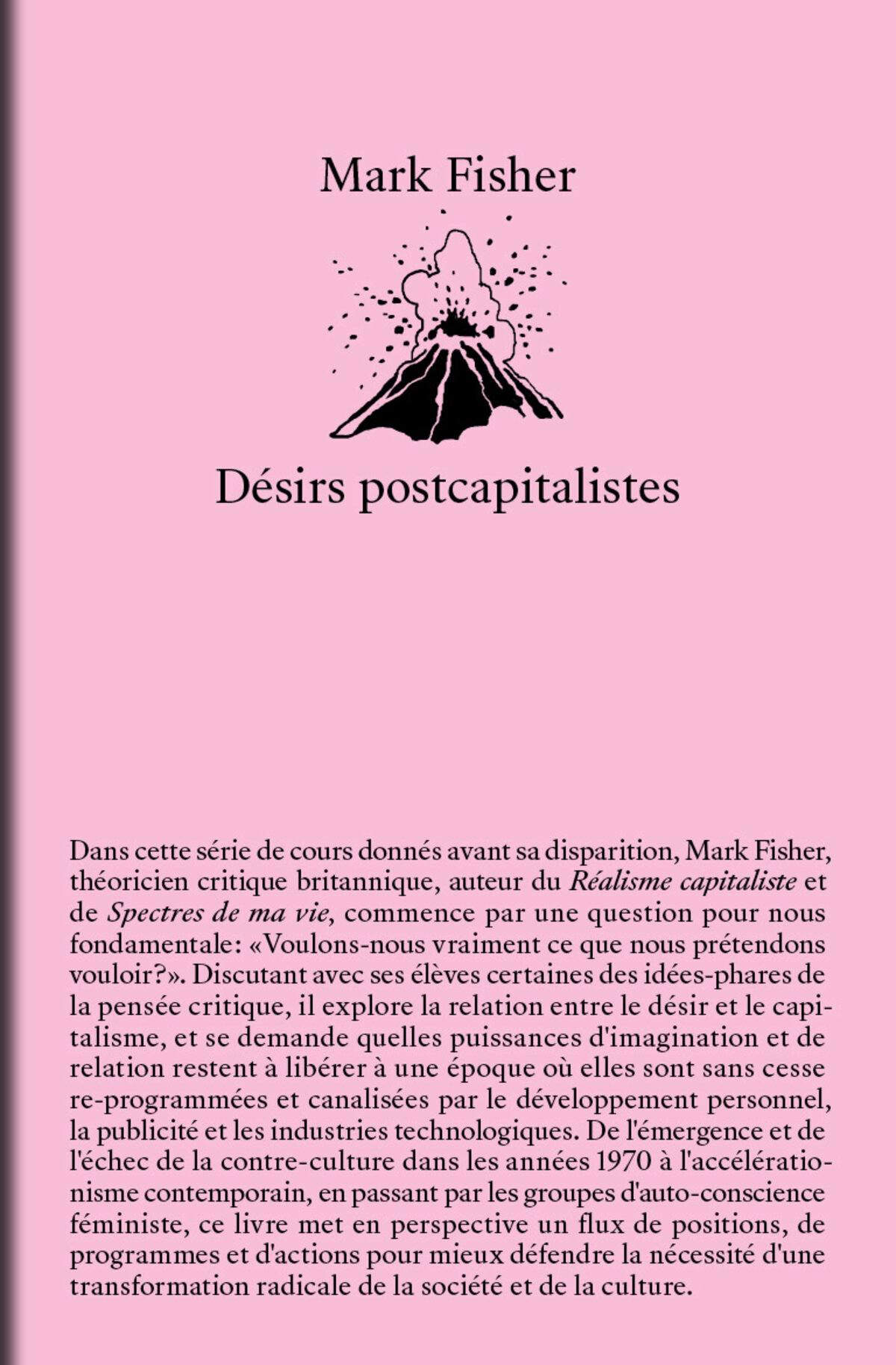
Mark Fisher – Désirs postcapitalistes © editions Audimat
Comme le documente si brillamment Mark Fisher, qu’il m’a fallu attendre 42 ans pour découvrir, le désir, comme tous les pans de notre vie économique, sociale, culturelle, est enserré dans le « réalisme capitaliste ». Notre désir est le produit de l’hégémonie culturelle dans laquelle, que nous soyons pleinement consentant, complice ou petit opposant, nous baignons chaque jour que dieu fait. Avant Fisher, Deleuze et Guattari dans les deux volumes de Schizophrénie et Capitalisme nous renseignaient déjà sur ce point. Si j’ai bien compris et suivi le fil de ces deux esprits, le désir ne se niche pas dans l’amour parental, dans un objet ou une personne convoitée. Le désir représente une multiplicité ordonnancé, un agencement. Un élément après l’autre se tisse afin de tendre, plus ou moins maladroitement, vers une multiplicité désirée. Gilles et Félix nous invite surtout à considérer la conquête majeur du capitalisme. La théorie économique libérale nous renseigne sur son ambition primaire : accumuler du capital. C’est le premier étage de la fusée. Il y a bien d’autres étages par lesquels l’hégémonie culturelle capitaliste travaille sans relâche afin d’extraire/capter/voler/dévoyer le vivant pour le transformer en marchandises/flux/faux désirs.
Le programme du capitalisme est d’arracher le désir. Nous voler le désir.
Et comme dans bien d’autres domaines, il est fort le bougre. Il est arrivé à ses fins.
Alors, comment donc pouvons-nous traverser le désir entaché par le monde tel qu’il est pour vouloir ce que l’on veut vraiment? La question est ardue : que voulons-nous VRAIMENT?
La semaine dernière, j’ai écouté un programme sur France Inter. Il s’agissait comme la radio les aime beaucoup (trop) d’un « débat » dont le titre était le suivant : sommes-nous rentrés dans l’ère de la récession sexuelle ?
Une intervenante, journaliste et autrice d’un podcast, évoquait la revendication de son orientation asexuelle. Elle précisait également qu’elle se définissait comme aromantique. J’avais déjà entendu, écouté et lu autour de l’asexualité, mais l’aromantisme, je dois l‘avouer, c’était une première. Ne voyez pas dans cette dernière phrase un début de sarcasme ou de condescendance à son endroit. Ce fut ma première réaction, je dois être honnête. A froid, pourtant, il me faut bien tenter de démêler cette nouvelle revendication au non désir.
Tirer le mot désir, et le terme sexe vient immédiatement. Puis, le champ lexical s’ouvre : phantasme, performance, consentement, plaisir, couple, sexualité, bisexualité, homosexualité, transsexualité, patriarcat, culture du viol, pornographie. Mais qu’y a t-il entre le territoire du désir et celui du sexe? Il y a certainement cet agencement, cette multiplicité, ces intensités complexes qui se frottent et se combinent pour valider le désir et aboutir, notamment mais non exclusivement, au plaisir sexuel. Il est tout à fait entendable que le désir s’exerce en dehors du plaisir sexuel et, en cela, l’asexualité semble être une orientation tout à fait sérieuse. Elle est certainement une orientation et une posture visant à contrer le patriarcat et la masculinité toxique, en réaction tout du moins aux héritages et présent de notre société patriarcale. Faire une croix sur le désir pour se sécuriser.
J’ai fait par la suite quelque recherche sur cette journaliste, Aline Laurent Mayard. J’ai découvert que, malgré son asexualité, elle désirait un enfant et a donc opté pour une PMA en solo. J’ai découvert également qu’elle était née dans une famille bourgeoise de la cossue Courbevoie et qu’elle a donc probablement fait une grande école, une de ses filières d’élites conçue pour les enfants des classes dominantes.
Journaliste, asexuelle, mère, autrice de podcast.
La question qui se pose alors me semble être la suivante : ne touchons-nous pas un point avancé de l’être néolibéral et, par la même, auto-suffisant?
Je m’explique. Cette personne, comme tant d’autres, opère des choix érigeant son moi comme sur-puissant, suffisamment pour délaisser la recherche du désir sexuel tout en se projetant seule dans la parentalité. Le capitalisme, depuis ses fondements jusqu’à ses mutations contemporaines à partir des années 1980, ne fait-il pas la promotion de l’individu entrepreneur de lui-même? L’homo neoliberalus choisit TOUT afin de contrôler TOUT. Telle une chaine d’usine imaginée par des ingénieurs pour garantir la plus grande fiabilité et productivité, l’individu est en maitrise totale. N’est-ce pas là la liberté tant vantée de notre système? On ne décide rien pour moi, je décide TOUT. Cet état d’esprit tourne à plein dans les programmes de développement personnel qui essaiment tant aujourd’hui et qui ont comme substrat théorique la psychologie positive. Ne pas se laisser envahir par ses émotions mais les guider grâce à ses pensées.
Nous y voilà donc. Depuis longtemps maintenant, le capitalisme atomise, explose les organisations collectives, réduit les marges de manœuvre des initiatives communes. Depuis la fin des enclosures et l’enterrement des communs jusqu’à l’asexualité et le développement personnel, le fil tiré est celui de la suprématie individuelle sur le collectif.
On enterre donc le désir et, avec lui, on enterre ce qui fonde la vie humaine : la relation.
Entrer en relation, chercher la relation, être en relation avec. La relation oblige la confrontation à l’autre, a l’altérité. Elle représente ainsi une somme de complexité, de joies mais aussi de déceptions. Si l’on considère le désir amoureux et sexuel, il recèle autant de climax que de dépressions. La relation est un miroir de l’existence, elle est entachée par nos manques et nos traumas, empêchés par les déterminismes sociologiques et culturels, bien souvent décevante.
Que nous reste t-il sans relation? Il reste notre moi. Il reste l’agrégation d’individus, comblant leur faux désirs sur les marchés truqués du capitalisme. Il reste des hommes et des femmes qui se parlent depuis des îlots inatteignables. Sur une piste de danse, il ne se passe plus rien. Sans relation, pas de désir et inversement.
Vous vous dites à ce stade que je vous avais promis un texte non dystopique, un truc un peu feel good qui convient bien avec la période estivale. Peut-être avez-vous été déçu par les dernières œuvres littéraires de nos ministres, Marlène Schiappa et Bruno Le Maire pour ne pas les citer qui, nous l’avons appris récemment, trouvent le temps d’écrire des livres jouissant d’un style tout à fait inimitable. Là, c’est sûr, c’est 100% sarcasme.
Il me faut ici revenir à mon point de départ et convoqué Mark Fisher. Nous devons nous résoudre à traverser cette époque trouble. Sortir du capitalisme constitue une illusion trop souvent convoquée pour nous rassurer, nous, résistants complices, nous, attachés à la relation, nous, femmes et hommes désirants. Il nous appartient d’accélérer cette traversée afin de connaître la fin de ce cauchemar, avant que les bactéries ne soient plus que les seules organismes vivants sur notre planète. Je ne suis ni devin, ni prospectiviste, ni astrologue, ni plus malin que vous. Mais soyez sûr d’une chose. Nous traverserons le capitalisme et un beau jour, qui sera aussi sombre que lumineux, nous le laisserons derrière nous.
Alors, peut-être, pourrons-nous de nouveau collectivement désirer ce que l’on veut VRAIMENT. Désirer l’autre, désirer la vie dans ce qu’elle comporte d’inconnues, de non contrôle, d’insaisissable. Nous nous brulerons autant que nous désirerons mais là est le prix à payer pour connaître, appréhender, saisir l’autre, les autres tout autant que soi-même.
Nous laisserons derrière nous cette appétence contemporaine à l’auto-suffisance et l’autodétermination. Nous enjamberons notre moi pour revenir à la raison désirante, la seule qui puisse être érigée comme une éthique satisfaisante pour notre espèce, celle-là même qui nous pousse à l’humilité et la modestie. Nous ne sommes rien sans l’autre. Nous ne sommes que parce que vous êtes. Nous recouvrirons les communs et la communauté, érigerons des forteresses collectives et tenterons de nous entendre, chose si difficile après des siècles de domination de la marchandise sur nos âmes.
Peut-être même que nous nous aimerons de nouveau suffisamment pour considérer à leur juste valeur et rôles les écosystèmes, les biotopes et les géographies qui nous ont précédés et nous obligent. Peut-être prendrons nous conscience de la terrible ubris qui nous a projeté dans l’auto-destruction.
Pour se faire, peut-être faudra t-il, comme en appelaient les révolutionnaires dont Jean-Luc Godard faisait partie, peut-être faudra-t-il exécuter sans procès. Oui, je sens bien votre malaise à la lecture de ces mots. Vous vous dites que j’en appelle à un certain ordre fasciste. Non, je n’appelle rien. Je considère simplement les déterminants historiques. Je considère la masse de morbidité, de violences, d’humiliations, d’inhumanité que le capitalisme a érigé en lois indépassables qui prennent tellement d’appellations aujourd’hui. Que faire alors pour les tenants de cet ordre? Seront-ils prêts à suivre notre communauté? Faudra t-il les rééduquer? Sont-ils déjà perdus? A mon humble avis, aucune de ses perspectives ne tient. Alors, peut-être faudra t-il les sacrifier pour nous permettre de grandir et de nous élever enfin.
Je voulais écrire sur le désir. J’ai écrit sur le capitalisme et sa traversée, son dépassement.
Vous comprenez enfin que mon désir se niche dans cette victoire que nous célébrerons lorsque la machine s’enrayera et poussera son dernier souffle. Je serai probablement mort lorsque nous entrerons dans le postcapitalisme. J’espère que ma fille le vivra. Mais quelle importance!
Nous sommes le fil tenu de l’histoire du désir, nous sommes cette complexité insaisissable, inaliénable, indomptable qui chérissons, désirons et célébrons l’autre. Nous sommes invincibles et immortels.
Nous sommes les femmes et les hommes désirant·e·s.
Joy Division – Love Will Tear Us Apart © Joy Division
Ce texte est le quatrième et dernier volet d’une série consacrée à la psychiatrie/antipsychiatrie et la maladie mentale, notamment, la dépression.